Il faut se rendre à l’évidence : nous, êtres humains, sommes égoïstes, individualistes et de manière évidente accrochés à tout privilège que le pouvoir permet d’acquérir. La bonne volonté et le partage avec nos pairs suivent le principe de Nielsen, et la plupart d’entre nous n’imaginent même pas que l’on puisse se comporter autrement, à moins d’y être obligés. Le Web social montre la voie à de nouvelles manières de faciliter l’échange de savoir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos organisations, mais les comportements collaboratifs, indispensables à l’éclosion de modes de travail en accord avec la nouvelle économie en réseau qui est en train de se dessiner, ne sont présents (voire même imaginables) que chez bien peu d’entre nous.
Communautés et confiance : la dure réalité
Dans ce contexte, les piliers de la collaboration efficace et créative que sont les communautés connectées et la confiance, risquent d’être bien plus difficile à mettre en œuvre que ne le proclament les apôtres de l’Entreprise 2.0. Le développement et l’accompagnement des communautés est un sujet à la mode, mais quelle réalité recouvre-t-il vraiment ? Qui dit communauté dit passion, et la passion signifie avant tout vouloir apprendre de ses pairs. Aucune vraie communauté ne peut exister sans passion. Des milliers de pages Facebook sont créées chaque jour au nom de la promesse presque toujours fallacieuse de construire des communautés. La page de Coca-Cola a environ quinze millions de fans, mais existe-t-il une seule raison d’appeler ce rassemblement une «communauté» ? Une quelconque interaction en profondeur ou, disons le mot, une quelconque collaboration y est-elle à l’œuvre ?
Version interne, cela ne fonctionne guère mieux. Au niveau de l’entreprise, la plupart du travail collaboratif est, en fait, du travail d’équipe, au sein duquel la coopération est alignée sur les tâches, de façon linéaire et prévisible. Les communautés de pratiques, qui développent avec le temps de véritables comportements collaboratifs et adaptatifs, reposent bien plus sur la passion, la patience et l’implication que sur les technologies 2.0. Elles fonctionnent généralement bien en ligne lorsqu’elles fonctionnent bien hors ligne. De plus, bien des exemples «réussis» d’initiatives autour de l’Entreprise 2.0 ne présentent comme preuve de cette réussite que les nombre de connections enregistrées et le nombre de «communautés» créées. Socialwashing à tous les étages.
La véritable collaboration requiert non seulement le développement d’un environnement collectif favorable, mais aussi de la confiance. Le problème est que la confiance est une qualité en voie de disparition. Les marques ne peuvent prétendre ignorer que les clients leur font chaque année de moins en moins confiance, et que cette érosion de la confiance s’exprime partout, y compris sur les médias sociaux. Dans les entreprises, le niveau de confiance est encore plus bas. Le micro-management, l’évaluation continue basée sur la performance dans des environnements de travail prédéfinis, la pression hiérarchique et économique, ont gravement endommagée la confiance parmi les employés. Dans la plupart des cas, la collaboration est une fumisterie.
Adoption ne vaut pas diffusion
Malgré tout, l’entreprise réellement collaborative est sans l’ombre d’un doute le modèle organisationnel le mieux adapté pour faire face à la complexité grandissante de nos environnements économiques, comme pour doter les écosystèmes de nos entreprises d’avantages compétitifs durables. Plus que jamais, les organisations doivent changer leur mode de pensée. Les travailleurs du savoir doivent continuellement pouvoir disposer de nouvelles ressources, tandis que travail et apprentissage doivent se fondre en un flux continu. Mais, alors que si peu d’entreprises sont suffisamment mûres pour accepter et adopter cette complexité et ainsi redéfinir le travail en termes de flux fluide et collaboratif, comment pouvons-nous aider et accompagner les autres ?
Bertrand Duperrin propose l’introduction de routines sociales dans le workflow quotidien des employés. Un tel modèle facilite l’adoption de pratiques collaboratives, mais ne tient compte ni des relations réelles entre les membres d’une entreprise et du manque sous-jacent de confiance, ni d’un des défauts majeurs des processus business : les «socialiser» permet plus facilement de prendre en compte les opérations floues ou incertaines, une approche voisine de celle des Barely Repeatable Processes de Thingamy, mais ne fonctionne pas correctement lorsque l’issue elle-même est incertaine. Les processus fonctionnent lorsque le résultat en est prévisible, ce qui est de moins en moins le cas.
Gil Yehuda vient de proposer un autre modèle, en proposant la mise en place d’une dynamique collaborative aux côtés des modèles traditionnels de management, basés sur la hiérarchie et les récompenses. C’est une vision très intéressante mais je crois que le développement de mécanismes collaboratifs modifiera profondément la structure des organisations, et que la coexistence des modèles n’est pas viable de la manière dont il le propose. Ce dont nous avons besoin n’est pas de forcer l’adoption de nouvelles pratiques dans des structures conservatrices, mais de faciliter leur diffusion, par l’utilisation et la modification de mécanismes existants, quoique latents, pour permettre l’émergence de nouvelles pratiques.
Redéfinir le client en interne
J’ai récemment écrit sur le nouveau type de relations que les entreprises peuvent (et doivent) construire avec leurs clients et leurs non clients. Ces relations ne sont pas basées sur une transaction, mais reposent sur la valeur que les entreprises peuvent créer en aidant les clients à résoudre les problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne, en leur proposant de meilleurs produits et services. Le Web social facilite cette logique à dominante service, permettant de recueillir davantage d’informations à partir des interactions entre les individus (c’est ce à quoi s’emploie le CRM Social). La mise en place de ce type de relation est un pré-requis de la collaboration, dont le but ultime est la co-création de valeur. Je ne parle pas là de communication ou de pseudo marketing des médias sociaux, mais d’un changement des fondamentaux de l’économie et du marketing. Le manque de confiance, et l’inconsistance des soi-disant «communautés de marque» ne posent pas de problème dans ce contexte. Pourquoi ne pas appliquer le même modèle en entreprise ?
Les «clients» ont toujours été une réalité interne. Mais les entreprises en ont aujourd’hui une perception périmée, la plupart des interactions internes étant orientées vers la vente de services ou le push des décisions du management vers les équipes. Plutôt que d’aider leurs clients à faire ce qu’ils ont à faire en entretenant une interaction constante, beaucoup de fonctions support les mettent au bout d’un entonnoir orienté processus. Par exemple, la DSI formalise en vain ses relations avec ses clients internes à travers la gestion des exigences, malgré leur inaptitude avérée à résoudre des problèmes réels en temps réel. Redéfinir le client interne en suivant une logique orientée service permettrait de jeter les bases organisationnelles de la collaboration. La plupart des services en bénéficierait; les Ressources Humaines, par exemple, pourrait mettre en place un vrai développement de carrière, au-delà des référentiels métiers et fonctions.
Au niveau individuel, la même définition du «client» (celui qui est impacté par nos actions et nos propositions) et un comportement identique généreraient une nouvelle forme de relations, et favoriseraient un changement de mentalité favorable à la collaboration. Que se passerait-il si les managers considéraient leurs équipes comme des clients ? Faciliter la tâche de ses subordonnés et observer la manière dont ils les gèrent… Comme me le faisait remarquer Olivier Blanchard, cela ressemble à de bonnes pratiques de leadership. Bien sûr, mais tandis que nous savons comment nous comporter envers nos clients, qui sait exactement ce qu’est un leader ?
Je crois que l’application en interne de ce que nous apprenons à faire vis-à-vis de nos clients externes fournit une solution concrète à la préparation du changement vers une entreprise collaborative, pour la grande majorité des entreprises pour qui la collaboration est une fumisterie. Je ne propose pas de modèle, juste un appel au passage à l’acte. Pour faciliter la diffusion de pratiques collaboratives, redéfinissons le client interne, et tenons en compte de la même manière que nous devons à présent tenir compte des clients de nos marques.



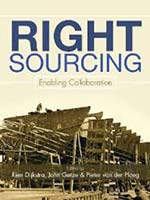


Tout a fait d’accord avec le fait que le RSE interne va au delà des communautés et doit s ancrer dans le travail collaboratif. C est pour cela qu’il faut inclure dans son projet la gestion documentaire et la gestion de projets ou au moins de taches. C est autour de ces objets qui structure le travail que l on peut laisser faire l intelligence collective
“ces objets qui structurent le travail”
Vous avez raison Frédéric, mais lorsque la structure actuelle du travail conduit à une diminution généralisée de la confiance, est-il possible de favoriser la collaboration sans modifier cette structure du travail ?
Pingback: Twitted by fcharles
Triste réalité mais je poursuis ma modeste contribution collaborative.
Le contexte devrait aider le bon sens à nous mettre dans la bonne direction … et il y a urgence !
alea jacta est
Oui, il y a urgence, notamment à considérer l’état des relations à l’intérieur de l’entreprise sans se voiler la face. Lorsque l’on parle de transparence, c’est ici qu’elle doit s’appliquer en premier…
Bjr je reviens suite à mon tweet pour compléter ma phrase. Ta remarque “la plupart du travail collaboratif est, en fait, du travail d’équipe, au sein duquel la coopération est alignée sur les tâches, de façon linéaire et prévisible” J’ajoute qu’il ne s’agit pas seulement de “coopération” mais aussi de “compétition” ce qui s’appelle “co-opétition” = mélange de compétition et de collaboration.
Bonjour Fadhila,
je viens juste de traduire un article de Sandy Styer sur l’évaluation de Thomas-Kilmann, qui suggère que collaboration = coopération + autoritarisme.
C’est là une définition de la “collaboration” qui renvoie notamment aux heures noires de l’histoire de France, mais est-ce bien celle que nous nous efforçons de mettre en place? J’en doute, peut-être est-ce là un glissement sémantique et culturel entre une conception anglo-saxonne et une conception française de la collaboration… Ton avis ?
C’est en tout cas une question à creuser davantage.
Thierry, Le mot co-opétition est d’origine militaire. Je rappelais que les entreprises qui mettent en place de la collaboration de manière linéaire et prévisible comme tu le soulignes ont également des systèmes de d’évaluation/notation individuelle. Ainsi rechercher “la confiance” dans un système qui mêle collaboration + compétition = co-opétition ; nécessite de parler de la confiance sur le plan individuel, collectif avec un axe transversal et vertical. Mais peut être suis-je en train de t’écarter de ton analyse première. Je revenais juste te dire que ta réflexion m’amenait à confronter l’idée de coopétion /confiance.
Tu m’en écartes sans doute, mais c’est là l’intérêt et la magie des commentaires 🙂
C’est vrai que la notion de confiance est souvent envisagée essentiellement dans sa dimension one-to-one, et correspond aux systèmes d’évaluation centrés sur l’individu.
Changer de paradigme nécessite également de penser “confiance” sur un plan plus large… Mais la confiance “organique” est-elle envisageable sans une solide confiance au plan individuelle ? Dans quelle mesure les deux sont-elles liées ? C’est sans doute une clef importante de la collaboration.
magnifique et terrible synthèse.
toutes les réalités que je m’obstine quotidiennement à omettre en plongeant ma tête dans le sable 2.0.
trop triste est la réalité 🙂
merci pour le principe de Nielsen, j’en parle souvent et ne savais pas qu’il était ainsi “officiellement” formulé.
Merci Jérôme,
ce sont des réalités que l’on côtoie hélas tous les jours, tant en entreprise que n’importe où ailleurs. La route vers une entreprise réellement collaborative est longue… mais je crois qu’elle existe.
Au-delà du risque d’une vision idyllique, il y a pour moi deux écueils majeurs à éviter:
– la vision anglo-saxonne de l’entreprise 2.0, vision dominante qui ne s’adapte pas si facilement que ça à notre mentalité européenne, voire latine
– cette vision est également celle qui est propagée par les vendeurs de solutions. Non seulement parce qu’ils sont majoritairement anglo-saxons (bien que les acteurs français commencent à prendre une vraie place dans ce paysage), mais aussi bien sûr parce que leur intérêt n’est pas de mettre les vrais obstacles comportementaux en lumière.
Pingback: Community manager : le poids des mots, le choc des cultures | InfGov's Blog par Claude Super
lecture attentive de votre post et commentaires..
Constat souvent partagé sur la réalité collaborative, trop souvent formulée comme une simple injonction, alors qu’elle questionne l’individu en profondeur: relation à l’autre, à la propriété (des idées, informations, documents…), au temps.
* Quelle propriété des idées ? Contrairement aux bien matériels…pour les idées, on ne peut jamais sortir de l’indivision ! La survie de l’espèce et de l’entreprise en dépend.
* L’indétermination de la durée des échanges est-elle nécessaire ? (Cf thèse d’Axelrod)
* Comment alors inscrire la collaboration dans un projet avec son indispensable planification ?
Il faut sans doute que l’ensemble soit piloté par des valeurs “supérieures”, qui soient stables dans
le temps. On parle régulièrement de la confiance, de la capacité au donnant-donnant, ou encore
prenant-prenant que je trouve plus juste.
Dans l’entreprise, dans le cycle de vie de l’information, le tout-à-l’égo ne sent parfois pas très bon. Rarement gage de fertilisation: le KM n’est pas un champ de salades. A ce titre Je trouve l’idée d’ego-altruisme de F SOUSSIN très puissante. A voir ses interventions en ligne dont http://ow.ly/38FHT
Je voulais mentionner ici un point qui n’est pas souvent abordé il me semble dans ce cadre des difficultés de la collaboration.
La règle du 80/20, souvent citée…et si rarement appliquée. Pourquoi ? On vante souvent, à juste titre, la nécessaire subsidiarité: je mène aussi loin que je peux telle tâche…et je passe le relais ensuite. Très bien…mais il faut être vigilant ici. Quel est mon horizon pour ces réalisations ? Il devrait porter sur les 20% de mes compétences où je suis le meilleur, le plus pertinent, le plus rapide, avec le plus de plaisir. Si chacun adopte cette règle, et le management (ou un animateur….) doit y veiller, les interactions se multiplient, avec plus de fluidité, de façon plus centrée, incarnée, et avec plus de “passion” et de force vitale.
Le plaisir retrouvé dans l’exécution de ces tâches, prendrait peut-être le dessus, sur la quête de reconnaissance, naturelle, mais mal placée, trop technocratique, et luttant contre l’intérêt du groupe.
Dans mon périmètre des 20%, il est plus facile d’asseoir ma renommée, puisque mes “avantages compétitifs” sont plus marqués. Le succès des projets communs est démultiplié…et cela peut entraîner le groupe, et pousser chacun à devenir meilleur….dans ses 20%.
Pour vos remarques et à poursuivre.
Merci pour ces remarques, Denys, les 80/20, oui, mais comment faire émerger (ou simplement déceler) chez chacun ces fameux 20% à l’intérieur desquels se retrouve passion et désir de partager ?
Bonjour Thierry et tous !
difficile à répondre. Il s’agit avant tout d’un processus individuel que cette découverte de nos 20%. Cela est lié à son projet de vie. Pas de pouvoir de prescription de l’organisation là-dessus normalement. Qq pistes de réflexion qd même:
– un collaborateur qui réalise rapidement, avec un plaisir manifeste et communicatif une activité…
– vous jugez le résultat parfaitement pertinent, vous êtes étonné. Vous n’en auriez pas fait autant…
– alors il est certainement dans ses 20%…surtout s’il ajoute: “cela ne m’a pas pris bcp de temps ni d’énergie, c’était plutôt facile, c’est normal, rien d’exceptionnel…”
– sauf que pour vous, le résultat EST exceptionnel !
Si l’on s’y prépare, ces manifestations existent quotidiennement. Souvent elles portent sur des choses qui nous semblent des “détails”. On ne prend pas tjrs la peine de demander si l’exercice fût un plaisir pour son “réalisateur”, et combien de temps cela lui a pris.
En restant attentif à ces manifestations d’authentiques talents, en les détectant chez plusieurs collaborateurs, cela vaut la peine de les faire travailler ensemble quand le projet s’y prête. Qu’en pensez-vous ? Au plaisir de poursuivre cet échange. Denys.
Merci pour ces réflexions Denys.
Elles rejoignent tout à fait ma suggestion de considérer collègues et équipes comme des clients internes.
Appliquer à l’intérieur-même de l’entreprise la même logique de co-création de valeur (celle qui est au coeur des approches de CRM Social), et donc d’écoute permanente, permettrait de déceler ces 20%, et, partant de là, de mettre en place non pas directement davantage de collaboration, mais davantage de comportements la facilitant.
Un autre résultat serait d”unifier” la manière dont écoute et conversation s’établissent et se structurent au-dehors (recentrées sur les clients) et à l’intérieur (recentrée sur les collaborateurs). Ce peut être là l’embryon d’écosystèmes de création de valeur.
Ah, t’as oublié Malsow – il faudrait remonter tous les employés dans l’hiérarchie de Maslow vers le niveau “Besoin d’accomplissement” 😉
Ehé, tu penses à l’article d’Esteban…
J’ai un problème avec Maslow, qui est d’ailleurs très bien exprimé dans la section “critiques” de la page Wikipedia.
La hiérarchie des besoins fonctionne certes dans une vision individualiste de l’individu, mais ne s’applique plus dès qu’un groupe partage des intérêts communs motivés par des sentiments ou une quelconque “morale”. C’est par exemple le cas chez les Alcooliques Anonymes (exemple souvent cité de collaboration) ou chez toute congrégation religieuse…
Pingback: Veille Antic #26