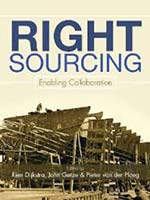Un tweet de Bertrand Duperrin, pendant l’Entreprise 2.0 summit qui vient de se tenir à Paris, m’a interpelé.
Nous savons tous (ou devrions savoir) que toute initiative “sociale” devrait commencer autour d’un problème business concret, tangible, à résoudre. “Vendre du social business”, quels que soient les outils qui seront mis en place, requiert une réelle compréhension du problème à résoudre, ainsi que des forces et faiblesses en présence. Cela va de pair avec la nécessité absolue de changer la manière dont les entreprises pensent que le travail se fait pour l’aligner avec celle dont il se fait vraiment: de manière collaborative, tout au long d’interactions et d’itérations ad hoc, au cours d’allers-retours successifs entre des interlocuteurs qui n’ont souvent qu’une vision partielle du problème à résoudre. Cela va également de pair avec la promesse de plus d’efficience, d’une meilleure performance opérationnelle. Cependant…
Cependant, une fois que l’entreprise a décidé de franchir le Rubicon, la réalité se rappelle à elle. Certaines parties prenantes essentielles ne peuvent utiliser les technologies nécessaires à cause de règles de firewall spécifiques ou d’un environnement légal strict. La norme ISO 9xxx interdit à certains utilisateurs l’accès (voire la visibilité) à certains documents importants. La messagerie vidéo est rendue impossible à cause de la faible bande passante disponible. Les salles destinées au comité de pilotage ne sont disponibles que le jeudi entre 9 et 11h. Les réunions ne peuvent pas être enregistrées, annihilant les efforts investis dans la préparation d’une série de webinaires. Certains managers, ne voyant pas la valeur qu’ils pourraient retirer de l’initiative, bloquent le plan de communication. Cette liste pourrait continuer à l’infini, et quiconque a travaillé dans une grande entreprise est capable de la compléter avec sa propre expérience. Bien sûr, tout cela aide les consultants qui peuvent ainsi facturer de nombreux jours de conseil destinés à éviter ces pièges, mais cela montre surtout à quel point nos entreprises dysfonctionnent.
Vous me traiterez peut-être d’idéaliste, mais lorsque les rotules d’un homme ont été usées par le port continu de trop lourdes charges, les remplacer par des prothèses de haute technologie n’est pas une solution. Lorsque les entreprises deviennent trop grosses pour se souvenir qu’elles sont avant tout une affaire d’hommes et de femmes, que la technologie, les processus, et même les structures organisationnelles sont des facilitateurs, la société est en danger. Les efforts des productivistes pour changer cette réalité ressemblent trop à un nouveau paradoxe de Zénon; le changement incrémental ne nous emmènera pas au-delà de la triste réalité que nous observons chaque jour: derrière le pauvre constat de ce que le travail représente pour beaucoup de nous, pensez à l’épuisement des ressources naturelles, au mépris de la créativité et de la bonne volonté humaines, à la disparité grandissante en terme de richesse… Le temps est venu de non seulement repenser la manière dont nous travaillons, mais la nature et la finalité de l’entreprise. Il est temps de réintroduire, comme le disait hier John Wenger, la sociologie et la psychologie dans notre approche. Il est temps de franchir le mur de la réalité, d’aider les entreprises lucides à devenir des Wirearchies ou des Organisations Légères.
Cela va être un long voyage, bien sûr. Mais la voie est à présent ouverte, aujourd’hui des guildes telles que Change Agents Worldwide ou Corporate Rebels United existent pour nous aider à tracer la route pour les autres. J’aurais aimé les avoir à mes côtés il y a quelques années. Comme l’a dit Anatole France: “Pour accomplir de grandes choses il ne suffit pas d’agir, il faut rêver; il ne suffit pas de calculer, il faut croire“.